 |
|
|
|
|
|
• Économie: Agriculture et Commerce • Écoles et Questions Scolaires
|
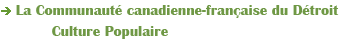
Le Progrès est une excellente source de renseignements
sur la culture populaire des Canadiens-français du Détroit à la fin du 19e
siècle. La culture populaire, qu’on peut aussi appeler le folklore, comprend les
coutumes, les traditions, les croyances, la littérature orale : bref, toutes les
connaissances transmises en dehors des voies officielles comme l’église, l’école
et la loi. On y retrouve des éléments de religion populaire, ainsi que des
contes, des légendes et des chansons, des proverbes et des dictons. Le
Progrès décrit des soirées et des célébrations, des coutumes du temps des
fêtes, des pratiques qui manifestent les valeurs de la communauté. Dans ce petit
îlot de langue française, la culture populaire sert à relier la communauté du
Détroit aux Canadiens-français partout en Amérique du Nord, tout en lui
permettant d’exprimer son identité régionale tout à fait particulière.
Le Progrès tient compte d’occasions favorables à la transmission de la
culture populaire - fêtes, soirées, réunions de famille. Bien que certaines de
ces occasions se rapprochent des voies officielles, elles laissent beaucoup de
place pour la transmission de chansons, de poèmes et de déclamations et pour le
maintien des pratiques coutumières. Par exemple, les soirées galas et les
concerts comme ceux qui ont lieu à Pointe-aux-Roches et à Rivière-aux-Canards
mêlent les chansons et les déclamations populaires à des présentations plus
littéraires  ,
,
 . Le pique-nique paroissial est une autre
occasion qui donne lieu à toutes sortes d’activités traditionnelles
. Le pique-nique paroissial est une autre
occasion qui donne lieu à toutes sortes d’activités traditionnelles  .
Les cadeaux qu’on échange lors de fêtes familiales nous laissent voir les objets
qui font partie de la culture matérielle de l’époque
.
Les cadeaux qu’on échange lors de fêtes familiales nous laissent voir les objets
qui font partie de la culture matérielle de l’époque  ,
,
 . Les
anniversaires de noces sont fêtés avec une importance qui grandit d’année en
année
. Les
anniversaires de noces sont fêtés avec une importance qui grandit d’année en
année  . De même, le calendrier liturgique est accompagné de fêtes
et de coutumes. Le Progrès décrit les traditions entourant la Fête des
rois, qui a lieu le 6 février
. De même, le calendrier liturgique est accompagné de fêtes
et de coutumes. Le Progrès décrit les traditions entourant la Fête des
rois, qui a lieu le 6 février  . Bien qu’elles relèvent de la
liturgie officielle, les pratiques associées au Carême font également partie des
observances populaires et sont beaucoup plus élaborées que celles pratiquées de
nos jours
. Bien qu’elles relèvent de la
liturgie officielle, les pratiques associées au Carême font également partie des
observances populaires et sont beaucoup plus élaborées que celles pratiquées de
nos jours  . Le Progrès ne peut laisser passer sous silence la grande fête
de Noël, qui est avant tout, à cette époque, une fête religieuse
. Le Progrès ne peut laisser passer sous silence la grande fête
de Noël, qui est avant tout, à cette époque, une fête religieuse  .
Mais on voit déjà, bien avant le tournant du siècle, l’arrivée d’un nouveau
personnage dans la conscience canadienne-française qui changera à jamais la
nature de Noël
.
Mais on voit déjà, bien avant le tournant du siècle, l’arrivée d’un nouveau
personnage dans la conscience canadienne-française qui changera à jamais la
nature de Noël  .
.
La tradition orale est représentée sporadiquement à travers les pages du
Progrès. On y retrouve plusieurs légendes canadiennes-françaises qui sont
alors en vogue dans les cercles littéraires du Québec, comme par exemple une
légende de loup-garou d’E.-Z. Massicotte, un des premiers folkloristes québécois  . Une autre histoire de loup-garou vient de l’Île d’Orléans
. Une autre histoire de loup-garou vient de l’Île d’Orléans  . Ces légendes font partie d’un fonds commun de croyances que
partagent les Canadiens-français du Détroit avec leurs compatriotes partout en
Amérique du Nord. Dans le même univers moral, on retrouve des histoires de
personnes possédées par le diable et avertis par des revenants
. Ces légendes font partie d’un fonds commun de croyances que
partagent les Canadiens-français du Détroit avec leurs compatriotes partout en
Amérique du Nord. Dans le même univers moral, on retrouve des histoires de
personnes possédées par le diable et avertis par des revenants  ,
,
 . Plus près de chez-soi, Le Progrès régale ses lecteurs
d’histoires de sorciers à Walkerville
. Plus près de chez-soi, Le Progrès régale ses lecteurs
d’histoires de sorciers à Walkerville  , d’un oiseau monstre à
Rivière-aux-Canards
, d’un oiseau monstre à
Rivière-aux-Canards  , de femmes tourmentées à Détroit
, de femmes tourmentées à Détroit  ,
,
 . D’autres histoires présentent des personnages légendaires qui font
appel à la fierté canadienne-française, comme celle du géant Edouard Beaupré
. D’autres histoires présentent des personnages légendaires qui font
appel à la fierté canadienne-française, comme celle du géant Edouard Beaupré  .
.
Que les gens y croient ou non, une légende est toujours présentée comme une
histoire vraie, et a comme but de renforcer les valeurs de la communauté. Les
contes populaires, pour leur part, sont racontés pour divertir les gens. Cette
forme est moins bien représentée dans Le Progrès. Mais on y retrouve
toutefois le petit récit à formule Minette et les roulettes  ainsi
qu’un traitement poétique du conte populaire du Petit Poucet
ainsi
qu’un traitement poétique du conte populaire du Petit Poucet  . À
la frontière entre le réel et le fantastique, on peut lire le récit terrifiant
de La Nuit des morts
. À
la frontière entre le réel et le fantastique, on peut lire le récit terrifiant
de La Nuit des morts  .
.
Il y des exemples intéressants de chansons populaires dans Le Progrès.
Parfois on imprime les paroles de chansons folkloriques bien connues ailleurs,
comme par exemple Trois beaux canards  et La légende de
Saint Nicolas
et La légende de
Saint Nicolas  . On nous donne aussi un échantillon d’une
chanson quelque peu grivoise provenant du confessionnal de l’église Saint-Joseph
à Rivière-aux-Canards
. On nous donne aussi un échantillon d’une
chanson quelque peu grivoise provenant du confessionnal de l’église Saint-Joseph
à Rivière-aux-Canards  . Mais Le Progrès est
particulièrement révélateur en ce qui concerne la pratique de composer des
chansons au sujet d’événements ponctuels dans la communauté. Une chanson de
Belle-Rivière accuse les constructeurs du nouveau quai du gouvernement de fraude
et de corruption
. Mais Le Progrès est
particulièrement révélateur en ce qui concerne la pratique de composer des
chansons au sujet d’événements ponctuels dans la communauté. Une chanson de
Belle-Rivière accuse les constructeurs du nouveau quai du gouvernement de fraude
et de corruption  . Deux autres chansons se moquent des partisans de
Bill McKee, candidat libéral largement vu comme politicien anti-français et
anti-catholique
. Deux autres chansons se moquent des partisans de
Bill McKee, candidat libéral largement vu comme politicien anti-français et
anti-catholique  ,
,
 . Une autre chanson, composée sur un air
connu, fait appel au patriotisme des électeurs canadiens-français lors de
l’élection fédérale de 1891
. Une autre chanson, composée sur un air
connu, fait appel au patriotisme des électeurs canadiens-français lors de
l’élection fédérale de 1891  .
.
Toujours dans le domaine de la tradition orale, on retrouve quelques dictons et
aphorismes concernant les pratiques agricoles  et la médecine populaire
et la médecine populaire  ainsi qu' une prière à Saint
Roch pour la guérison du choléra
ainsi qu' une prière à Saint
Roch pour la guérison du choléra  . Une liste de saints patrons
nous montre à qui s’adresser pour toute occasion
. Une liste de saints patrons
nous montre à qui s’adresser pour toute occasion  .
Des listes de proverbes paraissent aussi assez régulièrement dans les pages du
Progrès
.
Des listes de proverbes paraissent aussi assez régulièrement dans les pages du
Progrès  ,
,
 .
.
Enfin, deux pratiques traditionnelles mentionnées dans Le Progrès se
méritent une place ici. Le charivari était pratiqué par les membres d’une
communauté pour censurer un mariage qui allait contre les normes de la société;
normalement la pratique était réservée aux cas de veufs qui prenaient une
deuxième femme beaucoup trop jeune. Les jeunes de la paroisse allait donc, la
nuit des noces, entourer la maison des mariés en créant un vacarme avec pots et
chaudières qui assurait que le couple n’aurait aucune paix avant le lever du
soleil. Dans un incident rapporté à Tecumseh, l’événement déclencheur du
charivari semble avoir été un ménage à trois  .
.
Dans une cérémonie beaucoup plus tranquille, les habitants de Saint-Joachim
participent à une cérémonie religieuse destiné à débarrasser les champs d’une
infestation de chenilles  . Cette expression de religion
populaire remonte aux débuts de la Nouvelle-France et était encore pratiquée au 20e siècle.
. Cette expression de religion
populaire remonte aux débuts de la Nouvelle-France et était encore pratiquée au 20e siècle.


